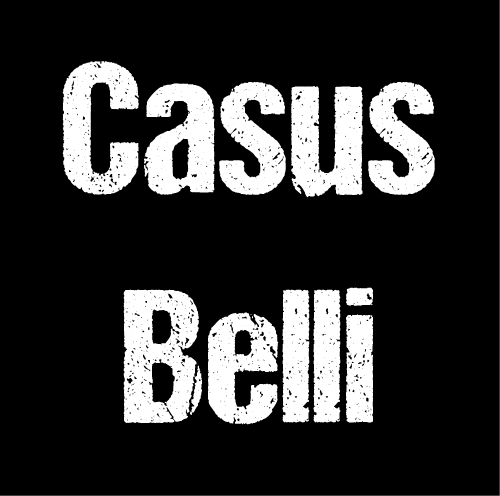« Camarades, et si on parlait de la guerre ? »
Pour ma tante, Pupetta, qui n’aimait pas la guerre
Pour commenter les élections européennes ne faudrait-il pas, aussi, parler de la guerre mondiale en cours ? Ce thème est, en France, totalement oublié (refoulé, diraient les psychanalystes). Et pourtant, la guerre est là, en Europe, à ses portes, partout. Il est tout à fait légitime d’affirmer que l’échec de l’axe Macron/Scholz est l’échec d’une politique atlantiste farouchement va-t-en-guerre.
Prendre au sérieux le vote lors des dernières élections du 9 juin signifie dire que les peuples d’Europe (ou, pour le moins, la moitié des peuples européens ayant droit au vote) ne veulent pas d’une économie de guerre, ne veulent pas d’un réarmement, sans que l’on puisse pour autant voir dans le choix pour les droites/extrêmes droites une consciente opposition à la guerre.
En effet, la progression de l’extrême droite est elle-même conséquence de ce que l’on peut appeler un régime de guerre mondiale.
L’autoritarisme politique et la gestion répressive de la crise économique, de la pauvreté et de toute manifestation de différence culturelle et politique par rapport au modèle occidental (criminalisation des voix propalestiniennes, durcissement des politiques migratoires, etc...), qui découlent également de la réduction des dépenses sociales au profit des crédits de guerre, nous confirment que nous sommes déjà dans un état d’exception. La gouvernementalité néolibérale semble avoir été épuisée. Sa force a été subsumée dans une autre force plus antique : la guerre. La crise hégémonique du bloc occidental et la crise économique qu’il vit ont, de nouveau, rassemblé les économies et les sociétés vers la guerre entre les États pour redessiner un partage du monde. Le rôle des chefs politiques occidentaux a été, ces derniers mois, d’accompagner ce changement de paradigme en déployant un puissant appareil idéologique qui justifie allègrement une explosion des recettes de l’industrie de l’armement. Au nom des valeurs démocratiques européennes, au nom des racines judéo-chrétiennes de notre culture, un certain ordre du discours associant libéraux, démocrates sincères, anciens communistes et quelques trotskistes a donc conduit à un climat général de normalisation, voire d’exaltation, de la violence, qui a fait le lit de la victoire électorale de la droite/extrême droite.
La guerre n’est plus la guerre des races, selon les termes du dernier Foucault, mais c’est, à nouveau, la vieille guerre interétatique (inter-impérialiste, pardonnez le langage désuet), une guerre pleine de boue et qui sent déjà la merde, les gaz et probablement les brûlures d’explosions thermonucléaires. Les ennemis intérieurs sont aujourd’hui le pacifiste, la fille au keffieh, tous ceux et toutes celles qui veulent se soustraire à la logique ami/ennemi de l’extérieur et défendre l’État-providence contre la disparition du budget au profit des dépenses de guerre.
Face au déploiement de cette nouvelle souveraineté fondée sur la guerre, que faire ?
La tâche principale, aujourd’hui, est de désarticuler les gestes et la posture de cette nouvelle souveraineté, la configuration économique, politique et spatiale du monde qu’elle veut imposer. Si l’on reste dans la guerre, en se ralliant aux côtés de Zelenski, de l’Otan ou de Poutine, rien n’enrayera la logique et la position des élites libérales et des fascistes. Ce que l’on ne dit pas, c’est que de longues années de guerre ou de préparation à la guerre nous attendent. Autrement dit, nous resterons prisonniers de l’angoisse, de la peur, de la haine, de tous les affects négatifs consubstantiels à une catastrophe généralisée. Le courage, aujourd’hui, ne consiste pas à prendre les armes (ou à envoyer des armes) afin de faire de Kiev notre Normandie (titre du quotidien, démocratique centre-gauche italien « La Repubblica », 7 juin 2024). Nous devons, plutôt, avoir le courage de déserter les commandements de nos gouvernements, car… « l’ennemi principal est toujours dans notre propre pays ».
Virginia Woolf écrit un texte émouvant sous les bombes de l’aviation nazie à Londres [1]. Elle aurait toutes les raisons du monde de se réjouir de la mort des soldats allemands, et de saluer les succès des jeunes aviateurs de son pays. Un mort, plusieurs morts parmi les ennemis signifieraient la Liberté. Mais elle s’interroge dramatiquement sur le sens d’une victoire et d’une liberté conquises par les armes. C’est pourquoi la vraie victoire, la vraie liberté sont, pour elle, la possibilité de libérer l’homme de la machine de la guerre. Virginia Woolf nous dit, en bref, depuis sa chambre noire de Londres, que le bonheur pour tous, notamment pour les soldats, est d’accéder aux sentiments créateurs, de sortir de sa propre prison à l’air libre. D’en finir avec les armes.
C’est ce programme – un programme qui revitalise les forces de l’imagination des humains et qui permettrait d’arracher l’enfant du siècle aux filets dans lesquels il a été enfermé (Benjamin) – qui pourrait être la riposte “de gauche” au régime actuel fondé partout sur la guerre.
C’est beaucoup plus qu’un programme électoral. C’est un mode d’existence : on se métamorphose pour ne plus se laisser capturer par les dispositifs et les passions tristes des pouvoirs, on devient-enfant, -femme, -oiseau pour se réveiller du cauchemar de l’histoire.
Il n’y a aucun moyen de lutter contre les dérives autoritaires, contre la lutte de tous contre tous, contre le darwinisme social si ce n’est en critiquant le régime de guerre mondiale. Les diverses manifestations contre le génocide en Palestine ont donné corps à un jeune mouvement transnational anti-guerre. Il peut constituer le noyau d’une nouvelle politique d’émancipation politique et sociale.
Face aux fascistes et aux fanatiques du libéralisme, la “gauche” ne saura renaître qu’en apprenant à se soustraire totalement à la politique globale de l’impérialisme. Autrement dit, seule une audace déserteuse nous sauvera.
Luca Salza