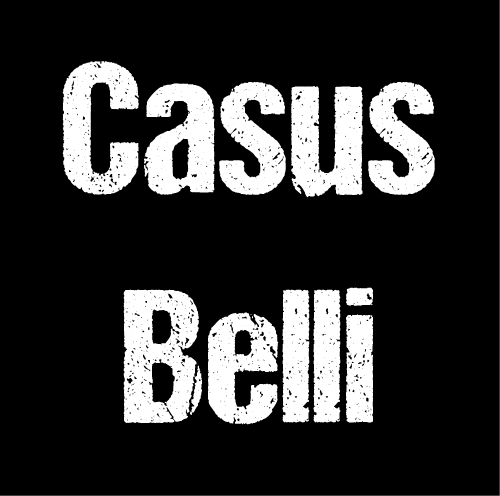Et s’il était déjà minuit dans le siècle ? [6/7]
Appendice 1
Ce que rendent possible les images politiques ou historiques fortes, c’est l’établissement d’homologies ou d’analogies entre des situations ou des configurations qu’au demeurant tout sépare. Le roman de Victor Serge auquel nous empruntons l’image du Minuit dans le siècle [1] est situé dans un milieu et un contexte historique constituant une forte singularité et présentant les contrastes les plus marqués avec notre présent ou notre actualité – la montée de la terreur de masse stalinienne, inaugurée par la répression des oppositions, ici l’Opposition de gauche trotskyste et assimilée. Le roman de Serge ne représente pas, il ne décrit pas, il ne relate pas – il développe ou construit une fiction vraie dont les personnages sont des militants de cette Opposition, leurs adversaires agents de la répression, avec, en arrière-plan, le peuple soviétique en proie aux affres de ces années de tourmente et de disette.
Le récit de Serge est éclaté en différentes scènes où apparaissent des protagonistes ayant en commun leur appartenance à cette communauté invisible, dispersée – les militants de l’opposition vaincue, traquée, emprisonnée, rescapés des temps héroïques de la Révolution et de la guerre civile et qui, tous et toutes, ont en partage, en ces années sombres où s’éteignent les feux de l’utopie, ces questions : à quoi bon continuer à résister ? Qu’espérer encore ? A quoi bon tenter de comprendre ce qui se passe ? – s’il s’avère qu’il est « déjà trop tard » et qu’il est minuit dans le siècle...
En même temps, ces révolutionnaires professionnels qui sont, pour la plupart, des intellectuels, férus de théorie marxiste, savent que le pire n’est pas encore consommé – les policiers qui les interrogent respectent encore certaines formes, les opposants arrêtés sont jetés dans des cellules puantes et surpeuplées mais pas (encore) systématiquement torturés ni liquidés – la terreur de masse n’est pas encore à son paroxysme, avec les exterminations en masse qui vont l’accompagner. Il est cependant déjà minuit dans le siècle dans la mesure même où la bifurcation fatale a eu lieu : Staline l’a emporté, il a désormais les mains libres et, de cet autocrate devenu entièrement étranger à l’esprit de la Révolution et au léninisme, il n’y a plus rien à espérer.
Cependant, au cœur même de ce tournant obscur, le lien vital avec Octobre ne s’est pas encore entièrement rompu, l’esprit de la Révolution mondiale continue d’inspirer les militants de l’opposition dispersés dans les isolateurs, les prisons, les camps, les grands chantiers – le Goulag en formation. Ils s’acharnent, envers et contre tout, à débattre âprement de la stratégie, des perspectives de la lutte, envers et contre tout, tantôt se divisant, tantôt faisant front contre l’Autocrate. Les « nouvelles » circulent sous la forme de messages rédigés sur de minuscules « petits rectangles de papier hygiénique », parcourant des milliers de kilomètres au hasard des déportations, des pérégrinations de tel ou tel membre de l’opposition [2]. Certains capitulent « pour avoir la paix », d’autres se font les avocats de la création d’un nouveau parti, d’autres encore s’évadent, en quête de lignes de fuite vers les vastes étendues de la Sibérie...
Mais, à ce stade où il est pourtant, dans l’esprit du roman, déjà minuit dans le siècle, la tradition révolutionnaire n’est pas rompue – tant que la discussion se poursuit parmi les opposants déportés, enfermés, tant que les nouvelles circulent. Les vaincus ne se font pas d’illusion sur ce qui se tient devant eux : « Quand ils auront bien compris ce qu’ils [les vainqueurs, la clique de Staline] font, ils se mettront à nous fusiller. Tous, je te le dis », pronostique l’un d’eux. Ce sera la terreur noire. Comment nous laisser vivre ? » [3].
Le roman de Serge se situe sur ce point de bascule où s’annonce comme imminente la Terreur généralisée – les grandes purges et les exterminations de masse (1937-38). Ce livre est ici à rapprocher de Dix ans au pays du mensonge déconcertant d’Ante Ciliga, autre grand narrateur, plutôt que « témoin », comme on dit, de ce tournant [4]. Dans l’un comme dans l’autre, ce qui retient l’attention, c’est l’admirable constance, la persévérance avec laquelle les vaincus, les réprouvés et réprimés des oppositions poursuivent la discussion dans les camps, les isolateurs, les cellules nauséabondes, s’informent, font circuler les nouvelles par tous les moyens disponibles. Tant qu’ils débattent, s’empoignent, argumentent selon les procédures de la « démocratie ouvrière » à coup de citations et de références aux père fondateurs, leur défaite n’est pas entièrement consommée. La discussion, la parole vivante qui circule, telle est leur planche de salut, leur arme contre la violence du pouvoir et l’adversité. Ils se sentent, dit l’un d’entre eux, « les seuls hommes libres sur la terre socialiste » [5].
Le titre même du roman de Serge laisse place à l’ombre d’un doute – S’il est minuit dans le siècle, c’est une supposition, davantage qu’une affirmation péremptoire. C’est dans cette brèche étroite que s’engouffre la passion inépuisable, inextinguible des opposants déportés et emprisonnés pour la discussion – une disposition qui rappelle les conversations animées qui, selon le témoignage de Victor Klemperer, se poursuivent parmi les Juifs de Dresde, alors que leurs rangs s’éclaircissent au fil des vagues de déportation [6]. La discussion, incluant les empoignades, c’est ce qui maintient en vie et c’est le signe de vie par excellence.
Inversement, leur dépérissement, leur disparition est signe de mort. C’est précisément quand plus aucun échange n’est possible avec l’ennemi, le persécuteur, qu’il importe que les réprouvés continuent non seulement de parler mais de se faire les gardiens de l’espace vital de la discussion, du débat. C’est ainsi que se maintient et se poursuit envers et contre tout une tradition – ici une tradition révolutionnaire, c’est-à-dire la « petite bougie clignotante par le grand vent de l’espace » d’une communauté révolutionnaire [7].
La défaite politique est une chose, l’interruption d’une tradition en est une autre. Politiquement, la défaite est consommée, c’est le leitmotiv du roman, la contre-révolution l’emporte, Octobre est désavoué. La défaite est une attrition sans fin : « Ainsi défaille une volonté usée. Tout cela ne mène nulle part. Tout cela est absurde. Résister ? Inutile. Ils peuvent tout. Céder une fois de plus, entrer dans le jeu, s’avilir, mentir, où cela mène-t-il ? » [8]. Au terme de l’accumulation des défaites, il ne reste rien : « Crois-moi, c’est fini. Après l’Allemagne, après la Chine, nous n’avons plus qu’à faire une croix sur nous-mêmes (capituler, que veux-tu que nous fassions d’autre ? » [9]
« Que faire s’il est minuit dans le siècle (…) puisqu’il ne reste plus rien (…) pas même l’espoir, le moindre espoir pour soi ? » [10]
Mais, précisément, il y a toujours cette petite musique lancinante du « si... » qui persiste, qui persévère – ce « si » qui est un conditionnel et qui laisse filtrer un mince rai de lumière. C’est que, par-delà l’espoir même, quelque chose de l’élan vital se maintient : « On ne peut pas vivre sans perspectives » [11], même s’il est déjà « trop tard », si « ta vie est finie » [12]. Alors, ce sont des images, comme des éclats de lumière, qui viennent prendre le relais de la réflexion : « Nikolkine (…) disait : « Pourvu que je vive assez pour voir dynamiter une prison socialiste, une seule, j’en demande pas plus à la révolution permanente... » [13].
L’interruption de la tradition, ce serait la clôture définitive, le parachèvement de la défaite. Et cela se jouerait dans les mots et les pensées, c’est-à-dire dans la capacité à agencer des discours – de penser par soi-même ; là où surgit cette anticipation proto-orwellienne : « Dans quelques années quand tous les vieux qui ont passé par les prisons du tsar seront morts, personne parmi les cent soixante-dix millions de citoyens de l’Union ne pourra s’imaginer ce que c’était que la liberté de penser... Il faudra être fou pour échapper aux idées fixes imprimées au pochoir mécanique dans les cerveaux... » [14].
Mais dans l’instant même où se boucle la boucle de la prédiction dystopique, se dessine au prix du plus grand des paradoxes, une ligne de fuite – ici, « devenir fou » pour échapper aux « idées fixes » du pouvoir omnipotent (pourquoi pas ?) ou bien, autre présomption tout aussi « folle », « former un nouveau parti », ou bien encore (et c’est sur cette image forte que s’achève le roman) s’évader de prison et s’enfuir vers la steppe ou la taïga, se fondre dans la masse des pionniers libres, un faux passeport en poche [15], et, par ce biais, revenir à la vie, ayant cessé de « ramper dans les boues de Thermidor » [16]. La vie qui revient, qui se poursuit et rajeunit envers et contre tout a alors le visage d’une femme prolétaire employée sur un chantier dans une ville en construction et qui, pendant la pause, se ragaillardit d’un coup de vodka : « Rodion vit tout cela, indiciblement, tout jusqu’aux graines en germination puisqu’elles sont réelles en vérité. Et que la femme qui buvait à cet instant l’eau-de-vie au goulot de la bouteille était vraiment, totalement, un être humain. Cela, il fut tout illuminé de le voir si bien » [17].
Ce sont les mots de la fin, ceux d’un humanisme révolutionnaire, dont on a même oublié qu’il a existé et compté, qu’il était vrai – tant le mot, le motif, la ritournelle en ont été galvaudés et prostitués dans la suite des temps – par les staliniens et les bien-pensants, dans la suite des temps. La ligne de fuite qui permet ici d’escompter que la tradition ne sera pas totalement et définitivement interrompue, elle prend forme et consistance, aux yeux du vaincu en cavale, dans l’interaction avec cette femme éclatante de vie et qui soigne son moral de prolétaire d’un coup de gnôle. La vie qui persiste, résiste et s’acharne, la vie qui s’obstine à affirmer ses droits contre la brutalité du pouvoir, dans toutes ses formes – détenu ou pas, il faut réaliser la norme pour manger...
Si nous pouvons éprouver aujourd’hui une forte émotion à relire ce roman « historique » de Victor Serge, comme le Journal de Victor Klemperer, ce n’est pas que nous l’identifions comme un « grand document », un « témoignage bouleversant » à propos d’une séquence devenue, à force d’éloignement, entièrement étrangère à la nôtre, exotique dans son étrangeté même. C’est au contraire qu’à son contact, nous devenons sensibles, au cœur du désastre obscur dont est fait notre propre présent, aux correspondances qui peuvent s’établir entre des singularités historiques, des présents ou des actualités que tout sépare mais que va néanmoins rapprocher, rabouter, le signe du désastre.
L’écho du désastre qui constitue le milieu où se situe le roman de Serge résonne en nous, en dépit de la radicale hétérogénéité des conditions du présent dans lequel il se situe et de celui qui, aujourd’hui, nous accable ; c’est que se tisse au fil de la lecture tout un réseau d’affinités tenaces quoiqu’à peu près inarticulables entre les dispositions des protagonistes du roman et les nôtres. Nous aussi éprouvons, dans notre présent même, la vanité de la proliférante rhétorique de la résistance, nous aussi sommes toujours bien près de renoncer à « comprendre » par quel enchaînement de circonstances funestes nous en sommes arrivés là où nous en sommes dans cette actualité associée elle aussi au chaos ; nous aussi sommes habités par ce sentiment de l’évidence qu’il est « trop tard », que notre défaite nous engage entièrement, et pas seulement nos engagements, convictions et positions politiques – « ta vie est finie ». Lorsque le motif de la capitulation revient dans S’il est minuit dans le siècle de façon lancinante, nous nous sentons sur le champ en terre de connaissance – nous vivons entourés de capitulards, de lâcheurs, d’opportunistes, de renégats ayant tout lâché de ce qui, dans leur vie antérieure, nous établissait en communauté avec eux – les voici convertis aux « valeurs » incarnées par l’OTAN, à l’intégrisme laïcard passé au brou de noix de l’agitation anti-islamique, ils ont fait leurs le bas de gamme de la propagande antitotalitaire, la promotion béate de la total-démocratie – ils ont capitulé sur toute la ligne.
La figure sous-jacente à l’établissement de ces correspondances (de ces échos prolongés que le roman de Serge fait retentir dans notre présent) est celle des analogies ou homomorphismes entre des singularités historiques hétérogènes. Ces singularités se subjectivent comme « présents », « actualités » entre lesquelles s’établissent pour ceux qui les vivent des intensités communes en dépit de leurs radicales disparités. C’est à ce titre que les protagonistes du roman deviennent, pour nous, des proches, des frères (et des sœurs) dans le partage du désastre – le désastre comme milieu d’expérience commune. Nous aussi savons que nous sommes entrés dans un temps où « il faudrait être fou pour échapper aux idées fixes imprimées au pochoir mécanique dans les cerveaux ». En ce sens, le désastre, même s’il se disperse de singularité en singularité, présente des traits récurrents, il ranime les mêmes spectres – la dévastation de la langue et des discours est toujours l’un de ses milieux privilégiés [18].
Le temps du désastre est celui dans lequel on ne sait plus ce à quoi l’on peut encore croire ou ce que l’on doit croire, malgré tout. Ou alors où le réalisme sombre mais lucide, rigoureusement analytique, exige que l’on abandonne toute croyance associée à l’espoir, à la lutte pour l’émancipation, à l’utopie [19]. Le temps du désastre est toujours celui de la peau de chagrin : le champ des « croyances » se réduit en même temps que celui de l’espérance. Mais, si on regarde de plus près, que ce soit dans le roman de Serge ou dans notre actualité même, il persiste toujours des îlots de croyance résiduelle, des môles, des bribes. On trouve dans le roman de Serge cette belle phrase imagée– elle a son siège dans le monologue intérieur de l’un de ses protagonistes : « Sur la Tamise, sur la Seine, sur la Sprée, de petits remorqueurs noirs crachotaient de la suie ; vieux sabots pour la plupart attestant bien l’usure du capitalisme [je souligne] » [20]. Usure du capitalisme, témoin de son obsolescence, annonciatrice elle-même de sa chute inexorable... Au cœur même du désastre remonte une bouffée d’optimisme automatisme – celui qui continue, envers et contre tout, à s’associer naturellement à la philosophie de l’Histoire de ces vaincus – le capitalisme est condamné, il s’use, il succombera sous le poids de ses contradictions, et c’est tout le domaine de l’espérance qui sera relancé...
Là aussi, alors même que nous nous trouvons confortablement nichés dans les plis du désastre, assignés à une situation personnelle (matérielle, morale même) située aux antipodes de celle que subissaient alors nos frères affamés et harcelés de l’Opposition de gauche, nous avons franchi plus d’un cap en matière dés-espérance, de dé-croyance, nous y sommes enfoncés, rivés autrement plus profondément qu’eux. Nous ne « croyons » plus à l’usure du capitalisme automatiquement associée à l’émancipation, à la libération des forces vives de l’humanité ; nous croyons ce que nous voyons, selon la formule consacrée, c’est à dire à un capitalisme qui, plutôt que s’user, mécaniquement, ne cesse de se relancer de rebond en rebond, via l’innovation, et qui, pour le reste, s’il semble bien mortel, nous promet assurément ne nous entraîner dans sa chute. Ce n’est pas pour rien que notre présent immédiat est placé sous le signe du fascisme environnemental [21].
Il n’existe pas de relation directe entre les conditions matérielles infligées aux vaincus de l’Histoire, la violence qu’ils subissent, d’une part et, de l’autre, la désorientation où ils se trouvent plongés. Il faut l’envisager froidement : notre dés-espérance luxueuse est, dans son fond, associée à la perte des repères, des points d’appui et, dans le sens courant et vague du terme, des croyances, infiniment plus radicale et éprouvante que celle que subissent les protagonistes du roman de Serge. Ces militants blanchis sous le harnais, endurcis par la lutte, ayant survécu à toutes les épreuves, sont encore habités par ce qui nous apparaît comme l’illusion lyrique associée à la révolution – à l’idée de révolution et au mythe révolutionnaire. Ecoutons l’un d’entre eux : « Nous avons raison, camarades, raison comme la pierre d’être dure, comme l’herbe de pousser : car la révolution ne veut pas s’éteindre. Sans nous, il n’en resterait que du ciment armé, des turbines, des haut-parleurs, des uniformes, des exploiteurs, des farceurs et des mouchards » [22]. Comme nous aimerions pouvoir encore articuler ce genre de belle période frappée au coin des certitudes inébranlables, envers et contre tout ! Comme nous aimerions que notre certitude d’avoir raison (nos raisons de croire que nous avons raison) soient aussi solides !
Au cœur de la défaite dont les conséquences les plus cataclysmiques vont s’étendre sur des décennies (la Grande Terreur et tout ce qui s’y enchaîne (le pacte de Staline avec Hitler, l’effrayant coût humain de l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht, l’expansion de l’archipel du Goulag …), les militants de l’Opposition continuent de penser et de parler, de former une communauté délibérative, à leurs propres conditions : « L’époque exige que nous ayons le courage de juger. Que faisons-nous dans les prisons ? Qui sauvera les hommes si ce n’est le prolétariat ? Qu’attendons-nous quand le prolétariat attend tout de nous ? [23] ». Bref, ils conservent la plus précieuse des boussoles – une théorie du salut ou, du moins, une exigence, une attente indissociable d’une sotériologie – ce qui résiste à la défaite : il faut sauver les hommes et cela, seul le prolétariat le peut. Equipé de ce bagage indestructible, on peut continuer à résister à toutes les usures, toutes les épreuves.
Mais c’est cela, précisément dont nous sommes orphelins – cette langue, nous ne la parlons plus, elle nous est devenue une langue morte. D’ailleurs, nous ne parlons plus du tout, ou guère, cela fait déjà un moment que le règne universel de la com’ digitalisée a asséché nos espaces de discussion – le temps des « nouvelles » passant de main en main sur des supports fragiles, le temps des « messages » qui entretiennent la flamme de l’espérance parmi la communauté des réprouvés est révolu – nos voix, quand elles s’élèvent encore, se fondent dans le brouhaha, la rumeur globale de la com’ et elles ne font plus la différence avec le tout venant du Grand Bavardage planétaire. De la même façon que les images n’existent plus qu’aux conditions du flux perpétuel, de la même façon, ce que nous disons, émettons et articulons encore à grand peine est emporté par le flux du Grand Bruit – la logorrhée sans fin qu’emportent les flots bourbeux de la com’.
C’est l’un des protagonistes de S’il est minuit dans le siècle qui le dit : « L’histoire est lente, elle ne tourne à l’ouragan qu’une fois tous les cent vingt ans, à peu près » [24] – soit, en gros, la distance qui sépare la Révolution française de la Révolution russe. Nul doute, donc, que, dans l’esprit de ce militant, l’ouragan qui vient interrompre brutalement le cours de l’ « histoire lente » ne constitue une coupure salutaire voire salvatrice – la Révolution russe, en dépit de toutes les défaillances et de toutes les trahisons demeure, en dépit de tout, un événement de cette espèce. Nous avons de plus en plus de peine à imaginer (car c’est bien ici d’imagination qu’il s’agit) un événement placé sous ce signe. Lorsque nous associons l’image d’une tempête, d’une commotion majeure à celle de l’interruption du cours des choses, c’est plutôt aujourd’hui en pensant à la guerre qui vient et qui, dans le temps de l’arme nucléaire, recèle des potentialités apocalyptiques, ou bien alors à une catastrophe environnementale majeure, associée à des désastres humains imprédictibles – guerres civiles, famines, déplacements de population... En ce sens même, notre dés-espérance analytique (par opposition ici à épidermique, émotionnelle) creuse donc infiniment plus profond que celle des vieux bolcheviks vaincus par la contre-révolution stalinienne, selon la fiction à la fois réaliste et lyrique de Victor Serge – cette fiction, au reste, découle de sa propre expérience, il en est passé lui aussi par-là, comme militant de l’opposition et il n’en fallut pas moins qu’une vaste campagne d’opinion, en Occident, pour que Staline lui permette de quitter l’URSS.
Alain Brossat
à suivre...