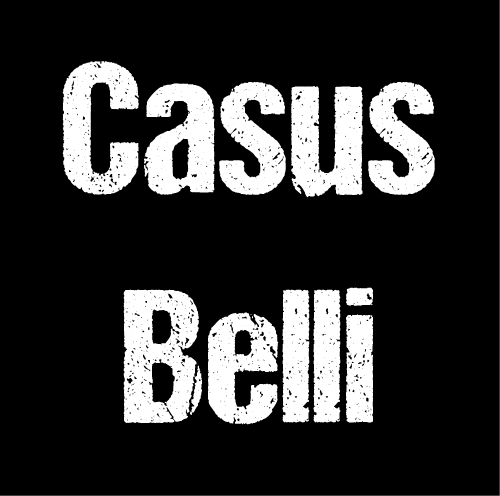Explorer le passé/présent en compagnie de Victor Klemperer [8]
Le sauvetage pris dans les plis du désastre (1/3)
Le chapitre 36 (« La preuve par l’exemple ») de LTI s’ouvre sur ces mots : « Au matin du 13 février 1945, on reçut l’ordre d’évacuer les derniers porteurs d’étoile qui restaient à Dresde. Préservés jusqu’ici de la déportation parce qu’ils vivaient en couples mixtes, voilà qu’ils étaient promis à une fin certaine ; il fallait s’en débarrasser en cours de route, car Auschwitz était depuis longtemps aux mains de l’ennemi et Theresienstadt très gravement menacé » [1].
A cette date fatidique est donc supposé s’achever le voyage de Klemperer au bout de la nuit du IIIème Reich. C’est l’issue qu’il attend depuis longtemps déjà, ayant percé à jour l’intention non seulement massacrante mais génocidaire des nazis – pas un Juif de Dresde ne doit demeurer en vie. Depuis 1941, les noms de Theresienstadt (le camp où l’on meurt beaucoup) et celui d’Auschwitz (le camp dont on ne revient pas) ont balisé le Journal, au gré des nouvelles qui lui parviennent, via la « rumeur juive », essentiellement. C’est donc le supplice de l’attente qui prend fin, en ce matin de février. On remarquera au passage que, jusqu’au bout (dans un chapitre où il est, plus que jamais, question de la LTI et de l’endurance de celle-ci dans les conditions même où le Reich est en train d’être emporté par la tempête de l’Histoire), le philologue demeure captif de l’objet de son étude même – au-delà du Journal, dans son essai même sur la langue nazie, rédigé dans l’après-coup, il s’en tient au terme mensonger d’évacuation – pour déportation... Les Juifs ne sont pas « évacués », ils sont entassés dans des wagons à bestiaux ou destinés au transport de marchandises, en vue de leur transport forcé vers les centres d’extermination – ou ce qu’il en reste à cette date.
Lorsqu’il reçoit notification de « l’ordre d’évacuation » (LTI !) Klemperer sait que celui-ci signe son arrêt de mort et il en évalue lucidement le débouché – les « évacués » seront liquidés « en cours de route », d’une façon ou d’une autre.
Le Journal fait mention, précédemment, de rumeurs évoquant les évacuations de camps bien connues aujourd’hui sous le nom de « marches de la mort ». Depuis que les déportations des Juifs de Dresde (comme d’ailleurs en Allemagne) ont pris un caractère sinistrement routinier, Klemperer voit son existence entièrement remise entre les mains du destin. Aucune alternative ne se dessine, aucune ligne de fuite n’est envisageable – seule l’attente du plus improbable des retournements (il emploie parfois le mot « miracle ») lui permet de supporter l’interminable attente du décret de mort annoncé par la Gestapo. Son cœur se déchire à l’idée de devoir être séparé pour toujours d’Eva, si vulnérable, mais le double suicide auquel s’est résolu un certain nombre de Juifs de Dresde n’a jamais été une option pour eux – jusqu’au bout, ils ont espéré que le mariage mixte pourrait être la petite lucarne par laquelle ils parviendraient à s’arracher, in extremis, aux griffes de la terreur nazie.
En réalité, si l’on se réfère au Journal, les choses se passent de manière un peu plus, disons, alambiquée, que ce qu’en dit Klemperer dans ce chapitre de LTI. On pourrait presque dire qu’elles se passent d’une façon plus sinistre encore que dans ce récit d’après-coup. En effet, à la date du 13 février, « mardi après-midi par un véritable temps de printemps », on trouve le récit détaillé et à tous égards déchirant de la mission confiée à Klemperer par les responsables de la Communauté, courroie de transmission entre l’administration nazie et les Juifs survivant à Dresde, qui l’ont requis (« Ulysse chez Polyphème », note-t-il) : il lui est demandé d’aller déposer chez ces personnes une « circulaire » les convoquant pour un transport, le vendredi suivant : « On devait se présenter le vendredi matin dans la Zeughausstrasse 3 en vêtement de travail, munis de bagages à main devant être portés sur un assez long trajet avec des provisions de bouche pour deux ou trois jours de voyage » [2]. Le fait que l’opération soit baptisée Arbeitseinsatz, comme s’il s’agissait d’aller travailler sur un chantier ou dans les champs, ne saurait faire illusion, note Klemperer – « elle est comprise par tout le monde comme une marche à la mort » [3]. La preuve : des enfants, nullement en âge de travailler, sont inclus dans le transport.
Klemperer, donc, est chargé de distribuer ces « circulaires » en forme d’arrêt de mort dans les foyers juifs parce que, précisément, il n’est pas inclus dans la liste de ceux qui sont convoqués pour cette nouvelle opération de déportation – « moi, en tant qu’exempté, je reste ici ». Mais il sait bien que cela ne représente pour lui que le plus fragile des sursis : « Le cœur m’a complètement lâché dans le premier quart d’heure, par la suite, je suis tombé dans un état de profonde apathie » [4].
Le voici donc parti pour s’acquitter de sa mission de messager de la mort, une « tournée » dont chaque station est une épreuve effroyable : « Il fallait d’abord que je prévienne Frau Stühler, elle en a été plus terriblement ébranlée que par la mort de son mari et elle est partie en courant, les yeux hagards, pour alerter des amis sur le sort de son Bernhard » [5]. Puis « Dans la Sedanstrasse, Frau Gaehde, qui a beaucoup vieilli, a écarquillé les yeux, la bouche si grande ouverte que le mouchoir qu’elle tenait devant son visage y disparaissait presque totalement, elle s’est mise à protester avec véhémence, la mine convulsée, le verbe haut : elle se battra jusqu’au bout contre cette ordonnance, elle ne peut pas abandonner son petit-fils de dix ans, son mari de soixante-dix ans, son gendre en captivité à l’étranger ’pour la cause allemande, allemande’, elle se battra, etc. » [6]. Et puis encore : « Ça a été terrible, malgré sa maîtrise de soi, chez une Frau Grosse dans la Renkstrasse, jolie villa près de l’église Saint-Luc (…) ’mon pauvre mari, il est malade, mon pauvre mari... moi-même, je suis tellement malade du cœur...’ J’ai essayé de la réconforter en lui disant que ça ne serait peut-être pas si terrible que ça, que ça ne pouvait pas durer longtemps, que les Russes se trouvaient près de Görlitz (...) » [7].
Chaque fois, le messager du Diable doit, de surcroît, extorquer la signature des victimes désignées, attestant qu’il a bien délivré la circulaire en mains propres... Plus loin, il remet le document à une jeune femme blonde accompagnée d’une mignonne petite fille... « Elle a lu le papier, a répété à plusieurs reprises toute décontenancée : ’Mais ma petite fille, que va-t-elle devenir ?’ puis elle a signé calmement avec un crayon. Pendant ce temps, l’enfant se poussait contre moi en me tendant son ours en peluche et en disant, rayonnante et joyeuse : ’Regarde, regarde, c’est mon petit ours, mon petit ours !’… Puis une Frau Tenor, absente, mais dont l’amie assure Klemperer qu’elle a « toujours redouté cette mesure » et qu’elle se suicidera. « Je lui ai instamment prêché le courage, la priant de remonter le moral à son amie »... La déchirante litanie se poursuit ainsi, jusqu’à cette « fille très jeune, très brune » qui lit le papier « tout à fait résignée », dit que « tout lui est désormais indifférent » – mais auprès de laquelle Klemperer doit insister longuement pour qu’elle accepte de signer le reçu... [8]
Retour au bureau de la communauté ensuite, où le messager retrouve un certain nombre de « candidats à la déportation » à qui il serre la main. « Vous venez aussi ? non ? », lui demandent-ils. Et aussitôt, sur sa réponse : « Le fossé était entre nous », infranchissable entre ceux dont l’arrêt de mort a été prononcé et celui auquel est accordé un infime supplément de survie. Klemperer s’entretient avec un certain Waldmann, lui aussi provisoirement épargné – « Il a développé avec une grande certitude l’hypothèse la plus sombre. ’Pourquoi emmène-t-on les enfants juifs ? (…) Il y a des intentions de meurtre là-derrière’. Et nous qui restons, ’nous n’avons qu’un sursis d’environ huit jours. Puis on viendra nous chercher dans nos lits à six heures du matin. Et nous aurons le même sort que les autres’ ». Klemperer (qui ne se résout jamais à voir s’évanouir toute espérance) objecte alors : « Mais pourquoi laisse-t-on ici un si petit reste ? Et surtout maintenant que le temps presse ? ». Mais son interlocuteur est intraitable : « Vous verrez que j’ai raison. » [9].
C’est en effet assurément Waldmann qui a raison : les derniers Juifs qui sont conservés en vie le sont pour des raisons utilitaires – l’appareil nazi a besoin d’intermédiaires, de petites mains, d’exécutants, dans la société juive elle-même (ce qu’il en reste) pour mener à bien son œuvre de mort. C’est, à l’échelle de Dresde, le même phénomène que celui des Conseils juifs dans les vastes ghettos où sont regroupés les Juifs en Europe de l’Est ou encore de l’UJIF en France. Ceux qui sont ménagés à cette fin seront les derniers tués, mais ils ne seront pas épargnés, leur statut de Juifs « protégés » ne les protégera pas. Klemperer est promis à la mort, comme les autres, mais la dernière « mission » dont il doit ici s’acquitter ajoute encore à l’horreur de la chose – le voici lui-même embarqué dans la mise en œuvre de l’extermination, assigné au rôle funèbre de messager de la mort et y ajoutant de son plein gré les illusoires consolations d’usage. In extremis, la victime désignée devient un rouage infime de la machine exterminatrice. Et jusqu’au bout, il entretient le faible espoir que son statut de Juif privilégié (protégé par son mariage avec une femme « aryenne ») serait susceptible de lui épargner la déportation. Etrange combinaison chez cet homme d’un pessimisme foncier et d’un reste indestructible de confiance en une heureuse providence susceptible de le sauver au dernier instant.
Un sauvetage in extremis a bien eu lieu, pour lui, et il est venu du ciel. Mais il est de forme cataclysmique – Armageddon en version industrielle. Le sauvetage de deux survivants au prix d’un urbicide résultant lui-même du paroxysme de la guerre aérienne au cours de la Seconde guerre mondiale. Un appareil de terreur en ensevelit un autre sous les bombes au phosphore, au prix donc d’un incendie généralisé, à l’échelle d’une ville entière, d’une intensité sans précédent. Jamais sans doute dans l’histoire de l’humanité la figure du sauvetage d’une singularité n’aura été indissolublement associée à un désastre de telle proportion. Ceci au point que la relation entre l’un et l’autre demeure à peu près impensable – le « miracle » du sauvetage du couple Klemperer – mais à quel prix – la destruction d’une ville de plus de 600 000 habitants, la mort de 25 à 40 000 personnes sous les bombardements (les évaluations ont beaucoup varié et ont fait l’objet de toutes sortes de surenchères propagandistes).
A partir du 22 février 1945, Klemperer renoue avec le Journal – une interruption de dix jours alors que ce qui constituait son monde de (sur)vie vient d’être pulvérisé et qu’il se trouve lancé sur les chemins d’un exode à haut risque – c’est finalement bien peu : tandis que tout se déchire et se discontinue autour de lui (il y a un avant et un après la destruction de Dresde par l’aviation anglo-américaine), tandis qu’il se trouve placé au cœur du désastre, non pas spectateur, non pas simplement témoin, mais otage, emporté par le souffle de la tempête de mort qui ravage sa ville, le Journal assure la continuité du récit de la catastrophe, envers et contre tout : dès qu’il est en mesure de le faire, le narrateur renoue le fil de la chronique. Ce narrateur va se définir désormais comme un double survivant – celui qui a réchappé de la « Solution finale » à la dernière minute et celui qui a survécu au bombardement qui a coûté la vie à des dizaines de milliers d’habitants de sa ville. Il est remarquable que le premier mouvement de Klemperer soit, dès qu’il est à nouveau en situation d’écrire (conditions minimales : un lieu abrité des intempéries, un stylo, des feuilles blanches ou un cahier, une table et une chaise ou peut-être le dos d’une valise...) de consigner ses souvenirs et impressions de ce qu’il désigne comme l’anéantissement (Vernichtung) de Dresde.
Or, par définition, le gouffre qui sépare la capacité humaine de témoigner d’un fait ou d’un événement et la puissance négative même de cet événement est ici béant. Une affaire de criante disproportion, d’absence de commune mesure. Le témoin/otage est emporté comme un fétu de paille par le souffle de la catastrophe, et c’est miracle s’il y survit. Mais, pour Klemperer, ce miracle (double – la destruction de Dresde interrompt le parachèvement de la « Solution finale ») ne suffit pas. Encore faut-il, impérieusement, se colleter avec lui en mots et phrases, en témoigner, c’est-à-dire, sous le régime d’écriture auquel il se tient envers et contre tout, s’essayer à en dresser le procès-verbal aussi précis, détaillé, sensible que possible. Ce n’est pas l’objectivité (impossible/impensable en l’occurrence) qui est ici la ligne d’horizon du chroniqueur, mais bien la précision. Dans la position du témoin/otage, la description ou le compte-rendu ne se séparent pas des impressions : il est « au milieu » de l’événement et celui-ci a la forme d’un maelström (Norbert Elias [10]), d’un séisme, d’un ouragan.
Il pourrait se réfugier derrière des adjectifs et se contenter de dire : ce déluge de feu, ces immeubles croulant sous les bombes, ces rues constellées de cadavres, c’est vraiment l’indicible, l’indescriptible, l’inimaginable. Mais non : il a un pacte avec le témoignage, le récit (c’est-à-dire avec lui-même) et il doit honorer cet engagement jusqu’au bout. Par conséquent, dès l’instant où il a pu reprendre son souffle et se poser provisoirement quelque part, il relève le gant et s’essaie à consigner l’épreuve extrême de la destruction de Dresde telle qu’il l’a vécue, traversée, éprouvée. Telle qu’il y a survécu.
La relation par Klemperer de l’événement « anéantissement de Dresde » ne se subsume pas sous le terme de description. La description suppose une distance, de quelque espèce celle-ci soit-elle, entre le sujet et l’objet. Or, ici, ce qui se trouve consigné, c’est avant tout l’épreuve que vient de traverser un sujet humain, épreuve si extrême qu’il ne peut qu’en témoigner, c’est-à-dire en rapporter ses impressions, les effets de choc, les éclats de souvenir. Ce récit en réveille un autre, plus célèbre : celui que fait Elias Canetti de l’émeute populaire qui déboucha sur l’incendie du Palais de Justice de Vienne le 15 juillet 1927, suite à l’acquittement inique des meurtriers d’ouvriers tués dans le Burgenland... [11]
En effet, en dépit des différences sensibles entre les deux situations, le témoin-narrateur se trouve, dans les deux cas, emporté par le tourbillon d’un événement cataclysmique (c’est le mot tempête qui revient avec insistance sous la plume de Klemperer, au fil des dix pages de cette évocation) dont le matériau ou l’élément dynamique est une masse humaine. Dans la séquence relatée par Canetti, il s’agit d’une masse en expansion dont il découvre (expérience inaugurale et fondamentale pour la suite de sa réflexion) la puissance irrésistible. Dans le cours de l’événement cataclysmique dont témoigne Klemperer, il s’agit d’une masse en panique, plutôt qu’en fuite (comme il en est question dans un chapitre de Masse et puissance [12]). Mais le lien solide qui unit les deux expériences de situations extrêmes et leurs relations respectives par Canetti et Klemperer, c’est la dissolution de l’individualité dans la masse, entendue comme une des expériences fondamentales de la modernité. Comme le jeune Canetti emporté par la houle de l’émeute court, halète, subit toutes sortes d’impressions sensorielles avec la masse, au cœur de la masse, Klemperer fuit les bombes incendiaires, s’abrite, se rapproche du fleuve (l’Elbe) en espérant y échapper au pire parmi la masse des rescapés ; toutes les impressions qu’il retient et consigne dans le Journal, après-coup, surgissent de l’intérieur de ces coulées humaines qui se forment sur les lieux du désastre.
Le solide terreau commun à la relation de ces deux événements, c’est leur total éloignement de toute approche normative/péjorative de la foule placée dans des conditions extrêmes – foules aveugles, en folie, déchaînées, etc. Ce qui intéresse les deux chroniqueurs, c’est le rapport qui s’établit entre une foule en fusion et un événement-tempête. Canetti en tire des conséquences théoriques, Klemperer, qui a horreur de la pensée spéculative, s’en tient à l’exactitude, ce que l’on pourrait appeler la morale rigoureuse du témoin. Mais aussi bien, l’une et l’autre approches de la masse se tient au plus loin du cliché dominant de la foule aveugle et dangereuse. Chez Klemperer comme chez Canetti, il n’y a pas l’ombre d’une « psychologie des foules ». Ce qui est en question, dans les deux textes, ce sont les mouvements de la masse humaine prise dans la dynamique d’un événement ou d’une situation dans laquelle les individualités sont brassées, homogénéisées et emportées, sans prise sur le cours des choses. L’événement est une vague immense qui les emporte et les submerge avant de les rejeter sur le sable de l’après-désastre [13].
L’objet de la relation de l’événement, c’est donc la consignation d’une collection d’images et de sensations qui ont été enregistrées par le narrateur lorsqu’il s’est trouvé pris dans ce tourbillon. Il ne s’agit pas de décrire des actions mais des déplacements, des jeux de forces – le milieu de la relation est physique et comportemental. Toutes les perceptions sont déformées, tous les repères de la vie ordinaire sont abolis. Le texte de Klemperer abonde en notations qui enregistrent ce phénomène de désorientation généralisée dans le temps incandescent de l’événement : les lieux les plus familiers sont devenus méconnaissables, là où se tenait un bâtiment se discerne un espace vide, curieusement vacant [14]. Les flammes de l’incendie abolissent la différence entre le jour et la nuit, la perception du temps par ceux qui sont plongés au milieu du chaos est totalement perturbée [15]. Les morts, les blessés, les agonisants, les rescapés sont agglutinés pêle-mêle dans les abris. Les gestes les plus simples sont susceptibles d’être emportés par la spirale monstrueuse de l’événement. Victor et Eva, par deux fois, sont séparés au cours des vagues successives de bombardements, ils sont à la recherche l’un de l’autre. « A un moment donné, relate Klemperer, tout en me cherchant, elle avait voulu allumer une cigarette et elle n’avait pas d’allumettes ; quelque chose se consumait par terre, elle avait voulu s’en servir – c’était un cadavre qui brûlait » [16].
Le cataclysme abolit toute espèce de continuité dans le temps comme dans l’espace. Seule la survie importe, avec les gestes effectués d’instinct et les éclats de pensée qui l’accompagnent – le narrateur se rappelle avoir entendu un « bourdonnement de mauvais augure », puis avoir été pris dans le souffle d’une explosion : « J’ai couru en direction du mur, il y avait là déjà plusieurs personnes allongées par terre, je me suis jeté au sol, la tête contre le mur, le visage dans mes bras. Et déjà une première bombe explosait et une pluie de gravier ruisselait sur moi. Je suis resté encore quelques instants allongé, je me disais : ’Surtout ne pas crever maintenant, après coup, ce serait trop bête !’ » [17].
Et pourtant, de cette collection de souvenirs épars de gestes, de sensations, d’instants, d’images hétéroclites, tant celles du narrateur lui-même que celles que lui a rapportées Eva, émergent des bribes de conduites rationnelles ou bien de sentiments d’humanité résistant à la pure et simple emprise du chaos. Ne voyant autour de lui qu’une mer de feu, Victor pense à Eva dont il a été séparé : « Eva était-elle perdue, avait-elle pu se sauver, avais-je trop peu pensé à elle ? » [18]. Dans le fracas et le feu de la tempête, quelque chose résiste à ce que Klemperer appelle la « destruction absolue » : « Une fois, j’ai demandé à des gens si je pouvais poser un moment mes affaires sur leur caisse, le temps de remettre en place ma couverture. Une autre fois, un homme s’est adressé à moi : ’Mais vous êtes juif vous aussi ? J’habite depuis hier dans votre maison’ – Löwenstamm. Sa femme m’a tendu une serviette pour que je me panse le visage » [19].
Et puis, au registre des signes de vie, non pas guidés par le seul instinct de survie mais bien par, à la fois le sentiment moral et l’intelligence du moment, il y a ce geste sublime d’Eva, quelques instants après leurs premières retrouvailles au hasard de leur errance sur le belvédère surplombant l’Elbe : ils rencontrent un Juif de leur connaissance et qui, désemparé, recherche sa famille : « (…) Je devrais retirer mon étoile, dit-il, comme lui avait déjà enlevé la sienne. Sur ce Eva arracha avec un petit canif de poche la stella de mon manteau » [20]. Plus tard, au début de leur exode, ce geste salutaire sera prolongé par la falsification du nom de Klemperer en Kleinpeter (100% « aryen ») sur le document d’identité de Victor.
En d’autres termes, la civilisation humaine survit par bribes tenaces au milieu du paysage d’apocalypse. La ville en feu n’est plus qu’un brasier infernal : « De nombreuses maisons de la rue en haut sortaient encore des flammes. Ici et là des corps, racornis et réduits pour l’essentiel à un petit tas de vêtements, gisaient éparpillés sur le chemin. L’un avait eu le crâne arraché, la tête était comme une coupe d’un rouge sombre. A un endroit, il y avait un bras par terre avec une main blême qui n’était pas sans beauté, comme on peut en voir en cire dans les vitrines des coiffeurs » [21].
C’est dans ce paysage même où la mort en masse est à l’œuvre activement (s’il ne s’agissait encore que des ruines...) qu’émergent, obstinément, des conduites humaines. La masse écrasée par les bombes, en panique, choquée ne succombe pas, dans le tableau dressé par Klemperer de la complète dévastation de Dresde, à de bas instincts grégaires et criminels comme dans le grand récit massophobe inauguré par Gustave Le Bon. Au contraire, ce qui émerge, ce sont les gestes de petite bonté, de solidarité, d’entraide. Au fil de leur déambulation parmi les ruines encore en flammes, dans les rues d’où s’élèvent des nuages de poussière, les Klemperer tombent sur un groupe de connaissances juives. L’une d’elle, un certain Waldmann raconte comme il a « sauvé une quarantaine de personnes, des Juifs et des aryens ». Un autre, Witkowsky figurait sur la liste de ceux qui, le vendredi suivant, devaient être déportés : « Cela m’a fait une drôle d’impression que Witkowsky, considéré comme irrémédiablement perdu, se trouve, robuste et agile, parmi les vivants » [22].
Alain Brossat
(à suivre...)