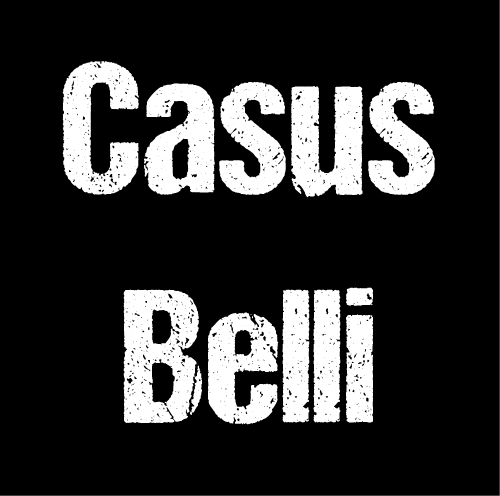Explorer le passé/présent en compagnie de Victor Klemperer [8]
Le sauvetage pris dans les plis du désastre (2/3)
Le relevé opéré par Klemperer de l’anéantissement de Dresde se définit moins comme une description du désastre que comme une phénoménologie des perceptions et sensations éprouvées par celui qui s’y trouve pris, totalement immergé. C’est, en vérité, une succession de chocs, avec les images et les mouvements qui en découlent. Les sensations et les visions, les moments se suivent, sans enchaînement, une succession d’intensités pures : « On a entendu tout à coup le bourdonnement de plus en plus sourd et intense d’une escadre qui se rapprochait, la lumière s’est éteinte, une déflagration tout près (…) Tout à coup, la fenêtre de la cave opposée à l’entrée s’est ouverte, et dehors il faisait clair comme en plein jour. Quelqu’un a crié : ‘Bombe incendiaire, il faut éteindre le feu !’ Deux personnes sont allées chercher la pompe à incendie et se sont activées bruyamment (…) J’avais perdu la notion du temps (…) Un vent violent soufflait, un terrible vent de tempête. Vent naturel ou vent d’incendie ? Sans doute les deux. » [1]
L’image qui parcourt et soutient tout le récit est celle de la tempête – l’incendie est un souffle de mort qui embrase la ville tandis que se succèdent les explosions. Une déflagration toute proche contraint Klemperer à se plaquer contre un mur et, quand il relève les yeux, Eva a disparu. Il ne le retrouvera que des heures plus tard, au hasard de son errance parmi les ruines. Il veut fuir vers un endroit moins exposé, enregistre un choc : « Puis un impact à la fenêtre près de moi, j’ai senti un choc violent et brûlant sur le côté de mon visage. J’y ai porté la main, ma main était pleine de sang, j’ai touché mon œil, il était encore là. Un groupe de Russes – d’où venaient-ils – se pressait vers la porte pour sortir. J’ai bondi pour les rejoindre. Le sac, je l’avais sur le dos, la sacoche grise avec nos manuscrits et les bijoux d’Eva à la main, le vieux chapeau m’avait échappé. J’ai trébuché et je suis tombé. Un Russe m’a relevé... » [2].
On assiste dans ce passage à la transformation, dans le milieu de l’événement catastrophique, du sujet individuel séparé en une sorte d’automate mu par les déplacements paniques de la masse en quête de salut. Mais en même temps, cette masse en fusion devenue le matériau humain (le combustible) de la « destruction totale » conserve jusqu’au bout une réserve de qualité humaine – le vieil homme tombe dans sa fuite éperdue, le prisonnier russe l’aide à se relever. La masse se déplace en bloc, par pans entiers, l’individu pris dans cette coulée humaine continue d’enregistrer des sensations, il n’est plus qu’un corps en tension, une masse nerveuse : « Déflagrations, lumière comme en plein jour, fracas de l’impact des bombes. Je ne pensais à rien, je n’avais même pas peur, il y avait seulement une formidable tension en moi, je crois que j’attendais la fin » [3].
A la peur de la mort (un sentiment éprouvé par le sujet humain dans l’ordinaire des jours) s’est substituée la sensation pure de l’attente de la fin, corrélat de la situation apocalyptique. L’homme de la masse pris au piège de la tempête tombée du ciel est entré dans un autre monde de la subjectivité humaine. Il se tient désormais par-delà tout ce qui constitue le tissu de la Sorge für... du souci de la vie dans ses formes ordinaires – la peur de la mort elle-même est abolie. Entouré d’une « mer de feu », il enregistre ses sensations de fin du monde et les gestes d’automate qui les accompagnent : « J’avais mis la couverture de laine – l’une, j’avais sans doute dû perdre l’autre en même temps que le chapeau – sur ma tête, elle cachait aussi l’étoile, je tenais à la main la précieuse sacoche et... mais oui, aussi la petite valise de cuir contenant les affaires en laine d’Eva, comment avais-je pu la garder à la main dans toutes ces escalades, c’est un mystère pour moi. La tempête m’arrachait constamment la couverture, me faisait mal à la tête. Il s’est mis à pleuvoir (...) » [4].
Le narrateur se souvient ici de la façon dont il s’est trouvé durablement dissocié de lui-même dans l’accomplissement même des gestes et la succession des mouvements (on ne saurait parler ici d’actions) qui ont peuplé sa quête instinctive du salut. Cependant, dès qu’un répit se présente dans cette fuite éperdue, il éprouve, dit-il, des « élancements de conscience » – « qu’en est-il d’Eva, pourquoi penses-tu si peu à elle ? ». Puis la catastrophe l’emporte de nouveau : « Il pleuvait, la tempête faisait rage (…) Je ne pensais à rien, il ne me venait que des bribes – Eva, pourquoi ne suis-je pas sans cesse en peine d’elle (…) ? (…) Je me tenais là, comme dans un demi-sommeil, et j’attendais que le jour se lève » [5].
On dirait ici que l’homme d’hier, celui d’avant la catastrophe, charpenté par ses attachements et son monde de vie (un homme marié et qui plus est amoureux de sa femme), a decent man très soucieux de ce qui s’associe à des formes de vie civilisées) et ce que l’on pourrait appeler la bête de survie plongée au cœur du désastre, qui n’est plus qu’un organisme vivant engagé dans une fuite éperdue, talonné par la tempête – l’un et l’autre se livrent une rude bataille. Et, en fin de compte, on ne saurait dire que, dans cet affrontement, l’homme d’avant, le civilisé ayant repris le dessus aura vu ses efforts (en vue de retrouver sa femme) couronnés, récompensés – c’est au contraire le pur hasard qui, au fil de son errance dans les lieux du désastre, reconduit ses pas vers Eva : « Finalement, sans doute vers sept heures, la terrasse – la terrasse interdite aux Juifs – s’était relativement vidée, j’ai longé le Belvédère toujours en train de flamber et je suis arrivé au mur de la terrasse. Des gens y étaient assis. Au bout d’une minute, quelqu’un m’a appelé par mon nom : Eva était assise là, saine et sauve, dans son manteau de fourrure sur sa valise. Nous nous sommes salués très affectueusement, et la perte de nos biens nous était parfaitement indifférente, et elle l’est encore aujourd’hui » [6].
Le désastre est, dans cette scène admirable, le creuset de ce qui apparaît bien comme un double prodige : il faut rien moins que la puissance du bombardement qui réduit la ville en miettes pour qu’enfin le règlement barbare interdisant l’accès du Belvédère (qui surplombe l’Elbe) aux Juifs soit pulvérisé et qu’en conséquence, le narrateur, encore affublé de son étoile, ose s’y risquer. Et puis, aussi bien, il n’en faut pas moins que la totale destruction de la ville pour que puisse se produire, sous les yeux du narrateur, cette quasi-surnaturelle apparition – Eva, sauve, enveloppée dans son manteau de fourrure et qui prononce son nom. L’admirable euphémisation du bonheur des retrouvailles sous la plume du bourgeois décidément coincé (en mode davantage protestant que juif, ici) qu’est Klemperer – « nous nous sommes salués très affectueusement » –, passablement kitsch et involontairement comique comme elle est, ne fait, au fond que renforcer, par contraste, le trait sublime du prodige. Nulle part, autant que dans cette image, les noces contre nature de la pure barbarie et du sauvetage contre tout espoir et toute raison n’auront été célébrées dans des termes aussi sobres, presque détachés – un ton de calme et convenable objectivité (surtout pas de pathos !) : « Nous nous sommes salués très affectueusement ».
Klemperer n’est pas seulement le témoin jusqu’au bout – il est aussi l’observateur qui consigne et engrange jusqu’au bout, tout en s’arrêtant dans le journal sur le seuil de l’analyse ou de la tentation de « théoriser » ce qu’il a relevé. Il pratique une sorte de « nouvelle objectivité » compréhensive fondée sur la combinaison de la présence, l’immersion (dans le cas présent plus que jamais) et d’une certaine distance que l’on peut se risquer à dire « critique ». Ainsi, il note, après ses retrouvailles avec Eva, que l’un et l’autre se sont conduits différemment pendant que les bombes s’abattaient sur la ville : « Eva avait beaucoup mieux réagi que moi, elle avait observé les choses plus calmement et elle avait trouvé son chemin toute seule, bien qu’à sa sortie du soupirail les planches d’un battant de fenêtre lui soient tombées sur la tête (…) La différence : elle a agi et observé et moi, j’ai suivi mon instinct, d’autres gens, et je n’ai rien vu du tout. Nous étions donc mercredi matin, le 14 février, nous avions sauvé nos vies et nous étions retrouvés » [7].
Aussitôt après, Eva découd l’étoile du manteau de Victor et ce geste, symboliquement, signifie non seulement leur émancipation de la tyrannie nazie, mais leur passage vers un autre monde, une autre époque (le franchissement de la Mer Rouge par les Juifs en exode ?).
Même dans le contexte de la « destruction absolue », lorsque se forme la masse en panique fuyant désespérément les lieux les plus exposés du désastre, demeure et persiste quelque chose de l’individualité, remarque Klemperer : Eva a agi avec calme, a observé et cherché la meilleure issue possible. Elle a conservé une certaine maîtrise d’elle-même, alors que, littéralement, les décombres s’abattaient sur elle. Klemperer, lui, s’est fondu dans la masse en fuite, il a agi par pur instinct, et, chose essentielle, il n’a rien vu. Ce dont il lui faut donc témoigner, c’est de ce qu’il n’a pas, à proprement parler, vu et encore moins observé, mais simplement éprouvé, au fil d’une succession ininterrompue de sensations, de chocs, d’impressions, d’éclats d’images. Il ne décrit donc pas l’anéantissement de Dresde, une ambition qui se tiendrait tout à fait hors de sa portée, il collationne des éléments qui s’y rapportent et les agence en un récit qui en est une reconstitution tout à fait partielle – ses propres souvenirs, ceux d’Eva et ce qu’il peut en inférer, des éléments généraux d’information rassemblés ultérieurement. Ce pourrait être une définition du désastre totale ou de la catastrophe absolue : ce dont il faut bien témoigner quoiqu’à vrai dire (que l’on y ait été submergé ou qu’on en ait été tenu trop éloigné), on n’en ait rien vu. Ici, celui-là même qui tient à intituler le volume de ses mémoires consacrés à la période de la guerre Je veux témoigner jusqu’au bout est le premier à dire : « je n’ai rien vu du tout ». Ce dont il faut témoigner (le « je veux » du titre fait entendre l’écho de cette injonction morale), c’est ce dont on n’a rien vu du tout.
Ce dont il faut témoigner peut-être en premier lieu, c’est de l’état second dans lequel se trouve rapidement le sujet humain pris sous le bombardement. La destruction ne se produit pas en une fois, mais par vagues, au fur et à mesure que les avions reviennent en essaim. Par deux fois, Eva disparaît tandis que les bombes s’abattent sur la ville. A la fuite éperdue succède, pendant les accalmies, une immense fatigue, augmentée par la faim, le manque de sommeil. On échange des paroles avec des inconnus, on enregistre des images et puis l’on s’endort n’importe où : « Quant à moi, j’ai beaucoup circulé ici et là, bavardant à l’occasion, puis je me suis accroupi sur un petit banc et j’ai dormi. Après cette nuit de catastrophe et cette copieuse marche de la matinée avec le sac à dos, j’étais si fatigué que je n’avais plus la moindre notion du temps. Il n’était pas plus tard que seize heures, et il me semblait que nous étions déjà au cœur de la deuxième nuit. La fatigue était encore accrue par la faim. Depuis le café de mardi soir, nous n’avions rien mangé du tout » [8].
Ce dont il faut témoigner, c’est de la soif dévorante, des blessés qui râlent dans les abris, et puis aussi des secouristes qui administrent des gouttes dans les yeux à la chaîne – « quantité de lésions oculaires », note Klemperer, et qui y ajoutent même le mot de petite bonté : « Allez, p’tit père, je ne vais pas vous faire du mal ! » [9]. Il faut témoigner de tout ce qui, à vrai dire, ne constitue pas un tout cohérent, mais une succession violemment dépareillée d’instants, une collection disparate d’intensités placées sous le signe du désastre.
Il faut témoigner de l’impossible : un sauvetage, c’est-à-dire un recommencement inespéré, surgi au cœur de l’anéantissement : « Nous étions donc mercredi matin le 14 février, nous avions sauvé nos vies et nous nous étions retrouvés » [10].
Témoigner de l’impossible, c’est évidemment le point limite du témoignage – ici, les dix pages du récit de la destruction de Dresde rejoignent les grands témoignages concentrationnaires – Antelme, Levi, Chalamov, Borowski, Kertész... Il faut témoigner d’une séquence apocalyptique dont on a traversé des moments entiers sans « la moindre pensée ni la moindre notion du temps » [11], en état de pure motion, déambulation automatique, comme un somnambule, témoigner donc de ce dont on n’a pas à proprement parler fait l’expérience, vécu, témoigner de tous ces temps d’absence à ce que l’on a pourtant été comme corps en mouvement et en quête instinctive de salut. Témoigner de sensations et d’impressions qui ont été déposées par la catastrophe dans le subconscient du narrateur. Rassembler le souvenir de conversations qu’il a eues avec d’autres rescapés pendant les accalmies, car il lui faut aussi témoigner pour les autres en collationnant ce qu’il a pu entendre et voir de leurs faits, gestes et paroles. Il faut témoigner du désastre comme d’une épreuve collective, évoquer les morts aussi, et ceux que l’on a vu souffrir et agoniser. Témoigner jusqu’au bout, c’est consigner l’épreuve jusqu’au bout, jusqu’à l’évacuation des rescapés en camion, les sains et saufs pressés sur les blessés couchés dans des civières : « Trajet cahoteux dans un paysage de ruines et d’incendies. Je ne pouvais pas voir grand-chose depuis mon siège, mais l’Albertplatz marquait la limite de la destruction intégrale » [12]. Mais du moins, lorsqu’il s’agit de faire monter les rescapés dans les camions, nul ne se soucia d’opérer le tri entre les représentants de l’espèce aryenne et les autres. Il n’aura fallu rien moins que cette « destruction intégrale » pour que soit aboli en pratique le décret infâme présidant à ce tri.
Telle est bien la consistance proprement impensable de l’événement apocalyptique : Witkowsky qui, le matin même du bombardement de Dresde devait partir en déportation, échappe à la mort promise (revient d’entre les morts, à peu de choses près) par la grâce monstrueuse de la réduction de la ville en ruines et en cendres. Le voici, « agile et robuste », plein de vie, qui se dresse au milieu des cadavres démembrés, carbonisés. Une image que l’on pourrait ici rapprocher de celle sur laquelle s’achève La Métamorphose : celle de la jeune fille, la sœur du personnage emporté par son devenir-cloporte et qui s’étire, insoucieuse et débordante de vitalité juvénile, tandis que la bonne balaie la pauvre dépouille de l’insecte. La discontinuité entre le « monde d’avant » (le bombardement) et celui du temps des ruines est ici radicale, mais, d’un point de vue juif (celui du survivant), sur un mode inversé : hier « déjà mort », le promis à l’extermination revit aujourd’hui en pleine santé au milieu des ruines, au cœur du désastre – celui-là même qui le sauve.
Klemperer ne perd pas une seconde à gloser philosophiquement ou métaphysiquement autour de cette image qui, pourtant, se prêterait si facilement à devenir une allégorie, un blason de l’époque, ou de l’à-présent placé sous ce signe : seul un nouveau désastre, plus puissant, pourra te sauver in extremis de la catastrophe en cours. Cette image (que l’on ne saurait décrire comme dialectique qu’au prix du plus criant des abus) ne condense pas les traits d’une situation unique, exceptionnelle – elle stylise tout un régime d’histoire. Ici, elle en stylise surtout la version providentielle. Mais généralement, le désastre qui efface le désastre n’offre pas ce supplément miraculeux. On pourrait multiplier les exemples – libérés des camps nazis, les prisonniers de guerre soviétiques qui ont survécu à leur extermination concertée par la faim, les chambres à gaz, le travail forcé et les épidémies se retrouvent en masse au goulag – leur reddition au temps de la défaite étant supposée non pas accuser l’aveuglement de Staline au temps de sa lune de miel avec Hitler mais résulter d’un abandon qui déshonore la patrie soviétique.
Klemperer ne glose pas, ne philosophe pas sur l’épreuve qu’il a traversée, allergique qu’il est à toute philosophie, la philosophie de l’Histoire-majuscule en particulier – le galimatias nazi a achevé de l’en dégoûter, si besoin était. Le témoignage est bien ici ce qui occupe la place de la philosophie, dans la mesure où il recèle, implicitement au moins, sa propre philosophie – ne pas gloser, ne pas se perdre dans les abstractions, se défier des châteaux d’idées (autour desquels rôdent les spectres de l’idéologie et la propagande) et s’en tenir au plus près à l’observation participante du réel, noter, glaner et consigner, mais sans jamais se contraindre à une fausse objectivité qui comprimerait le sens critique et boucherait l’angle de vue du scribe qui, précisément, est, en sus, un narrateur.
Klemperer se (re)tient en deçà ou à côté, en dehors de la philosophie, mais pas de la pensée critique et du jugement. C’est en ce sens que son témoignage communique, envers et contre tout, avec la philosophie – il met celle-ci sur la voie de ce qui constitue le signe caché, le hiéroglyphe de l’époque qui s’est symboliquement inaugurée avec des désastres (qui sont aussi des crimes d’Etat) comme Hiroshima, Nagasaki, Dresde – des désastres-crimes dont la particularité est d’interrompre un autre désastre – les guerres de conquête conduites par le régime nazi et le régime militaro-fasciste japonais dans leurs sphères d’expansion respectives.
Ce que le témoignage de Klemperer à son acmé – la destruction « salvatrice » de Dresde par les aviations alliées – ne dit pas, c’est que ce moment paroxystique ne se place pas tant sous le signe de l’exception absolue qu’il inaugure une règle. Mais il nous met sur la piste de ce signe caché. Klemperer, après la chute du régime nazi, adhère bien, existentiellement parlant, à la notion d’une normalisation des conditions générales, puisqu’il opère le choix de relancer sa carrière, d’occuper des responsabilités dans la nouvelle Allemagne placée sous tutelle soviétique. Mais en même temps, son Journal de la seconde moitié de l’année 1945 témoigne bien de ses doutes quant à la qualité, l’authenticité de cette normalisation – comme toujours, c’est le langage qui est le premier de ses observatoires ; or il se trouve que, sous ses yeux, la chienlit de la LTI n’en finit pas de se reproduire sous la forme d’une LQI à la mode soviétique.
La philosophie pratique de l’Histoire qui point ou pointe (le bout de son nez) ici est aussi abrupte que drastique – un désastre chasse l’autre. En 1953, Klemperer sera aux premières loges pour assister à l’émeute sanglante qui, dans les rues de Berlin-Est, met aux prises le prolétariat de la ville et les troupes soviétiques accompagnées de blindés. Et il n’aura alors rien vu – la conjugaison du cataclysme et du plus douteux des miracles avec l’effondrement de la RDA et le rattachement de l’Allemagne de l’Est à la RFA capitaliste et atlantiste... C’est que, si l’on veut comprendre quelque chose, généalogiquement parlant, à la guerre russo-ukrainienne d’aujourd’hui, autre désastre, il importe de remonter jusqu’à cette scène primitive.
La philosophie de l’Histoire dont le cœur tient dans cette formule – un désastre chasse l’autre – se distingue en tous points d’une philosophie dialectique prompte à statuer qu’il faut, parfois, en passer par le négatif (d’une épreuve majeure, d’une défaite, d’une catastrophe) pour, en la surmontant, repartir d’un bon pas. Elle est également étrangère à toute philosophie de l’Histoire fondée sur l’opposition entre la règle et l’exception – les temps « normaux » (temps placés sous le signe générique de « la paix », la stabilité, la reproduction des conditions ordinaires de l’existence sociale, de la vie politique, l’activité économique, les relations entre peuples et nations) ; et, d’autre part, les séquences placées sous le signe de l’exception, laquelle est généralement violente, souvent guerrière et, d’une façon générale, associée à des notions comme celles de la catastrophe, du désastre, du cataclysme...
Si l’on envisage au contraire la succession des temps (des époques entendues comme singularités et des moments présents, dans leur trait propre, irréductible à tout autre), alors le normal, la normalité et les normalisations de toutes espèces doivent être dénoncées comme l’alpha et l’oméga des mystifications – auto-mystifications, en premier lieu – la façon dont un présent se perçoit lui-même comme placé sous le signe de la normalité.
Alain Brossat
(à suivre...)