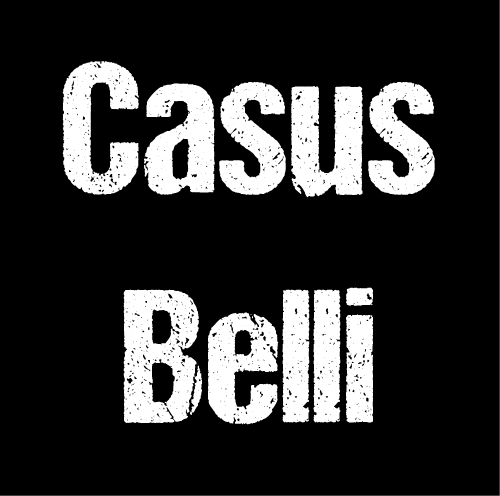Explorer le passé/présent en compagnie de Victor Klemperer [8]
Le sauvetage pris dans les plis du désastre (3/3)
Après un désastre majeur, les vivants sont habités par un puissant désir de retour à la normalité, généralement associée à la paix et au cours de la vie qui reprend, dans toutes ses dimensions. Mais ce désir si impérieux est un cache-misère et il dresse des écrans entre le présent post-catastrophique et ceux qui en sont les protagonistes. On peut ici se référer au corpus immense et infiniment riche des films d’après-guerre, notamment les films japonais et états-uniens réalisés durant les années suivant la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y apparaît distinctement (en dépit de la radicale différence supposée entre les conditions prévalant dans un pays en ruines comme le Japon et dans celui qui est le grand vainqueur de l’affrontement qui vient de prendre fin) que ce qui succède au paroxysme de violence de la guerre, avec le chaos et les épreuves collectives qui l’accompagnent, ce n’est pas ce que l’on en espère : pour l’essentiel, un nouveau printemps de la vie ; c’est, bien plutôt un âge placé sous le signe d’un nouveau désastre obscur, un désastre qui n’a pas encore de nom : années de dépression où prospèrent le crime et les combines, où les opportunistes et les sans scrupules s’enrichissent et triomphent insolemment tandis que la grande masse végète et survit dans la rage et l’humiliation, surplombée par ces maux typiques d’après-guerre que sont le chômage, la prostitution, les pénuries, la criminalité galopante, la misère, la faim, les maladies, les suicides... Un désastre chasse l’autre, cela veut dire, dans le contexte japonais et pour reprendre le titre d’un film célèbre : après le temps des cuirassés, celui des cochons [1]. Il n’y a pas de « retour à la normale », l’après-guerre est une autre figure du malheur, pour les femmes notamment, les veuves de guerre et les autres...
Il n’y a donc pas, à proprement parler, d’enchaînement d’une époque sur l’autre, mais plutôt empilement des désastres – c’est l’image de l’accumulation des ruines « jusqu’au ciel » que Benjamin oppose justement à la philosophie de l’histoire progressiste, une histoire qui poursuivrait irrésistiblement sa marche « à travers un temps homogène et vide » [2]. Au contraire, la succession en forme de stratification des moments ou âges désastreux est placée sous le signe des intensités négatives. Chaque désastre a son mode d’intensité propre – on voit bien, dans le Journal de Klemperer que la terreur nazie, c’est une intensité qui a sa coloration propre (tout particulièrement pour les Juifs), tandis que le moment-terreur de la destruction de Dresde, c’est un tout autre monde d’intensité(s) associé à la terreur aussi – une autre modalité de la terreur.
On passe sans transition d’un régime d’intensités négatives, paroxystiques, à l’autre et le souvenir des unes et des autres s’ « empile » dans la mémoire des survivants. On va les appeler des miraculés, ceux-ci, mais le prodige de leur survie est un faux-miracle puisque leur sauvetage les jette dans un nouveau maelström : sorti sain et sauf et par miracle de la grotte de Polyphème, Klemperer trouve refuge dans l’antre du frère jumeau du premier – en 1945, le stalinisme classique (associé à la terreur de masse et portant les traits du totalitarisme classique) a encore de beaux jours devant lui. Klemperer, une nouvelle fois, va passer entre le gouttes – mais il n’en vit pas moins dans le périmètre de cet autre topos désastreux et il lui faut bien s’y adapter, c’est-à-dire, entre autre, plier un peu l’échine et s’abêtir. Il a suffisamment écrit et répété dans les pages du Journal des années brunes que nazisme et « bolchévisme », c’était bonnet noir et blanc bonnet pour ne pas se faire, sur le fond, beaucoup d’illusions à ce propos...
Mais c’est qu’il ne suffit pas de survivre au désastre, encore faut-il vivre, après, c’est-à-dire revenir à une vie dont on devra se convaincre qu’elle est placée sous le signe de la normalité. Alors, Klemperer procédera aux ajustements de conviction et d’adhésion nécessaires pour donner corps et consistance à cette illusion – il redeviendra un professeur titulaire, adhérera au parti communiste, suivra un honorable parcours de notable dans la RDA commençante...
Nourrir, dans ces conditions, l’illusion du retour à la normale, c’est une illusion vitale, une ruse de la vie. Mais, en vérité, cette normalité est un miroir aux alouettes – très tôt, le miroir montre ses fêlures (1953), son tain s’écaille, il se brise en mille miettes en 1989. Après la chute de la RDA prospère dans la nouvelle Allemagne « réunifiée » (mais la réunification est un autre de ces faux miracles, un faux-miracle XXL) toute une démonologie de l’ancienne Allemagne de l’Est, avec son système de surveillance orwellien placé sous la coupe de la Stasi, ses persécutions politiques – mais comme toujours, ici, cette mise en scène du désastre (la RDA comme Etat policier) en cache un autre, ou bien d’autres : en premier lieu, celui qu’a constitué le basculement sauvage et chaotique de l’ « autre Europe » dans le camp d’un Occident sans qualité(s), trouvant dans cette manne un second souffle inespéré.
Dans le temps qui suit un désastre, la vie insiste pour réaffirmer ses droits, comme dans le rythme des saisons, le printemps affirme les siens lorsque l’hiver se retire. Les vivants qui ont traversé le désastre et en sont revenus désirent de toutes leurs forces que la vie reprenne et donc que « les choses aillent mieux », et de mieux en mieux, qu’une nouvelle ère placée sous le signe du renouveau s’inaugure, et relègue dans le passé les horreurs et les rigueurs du désastre. Deux principes, également vitaux, entrent ici en conflit. En tout premier lieu, le désir de reprise, de relance de la vie, qui suppose le congé donné au signe de mort sous lequel est placé le désastre, une réorientation vers la paix, la quête de la stabilité, la prospérité, et pourquoi pas le bonheur, par opposition aux malheurs associés au désastre (la guerre ou autre).
Mais cette puissante aspiration au renouveau de la vie est porteuse de méconnaissance. Elle nourrit, auprès de ceux qui l’éprouvent, la fausse conscience du présent. Elle se dope à l’espérance, elle se gorge de promesses et ne veut rien voir ni savoir des signes qui balisent le chemin sur lequel progresse déjà un nouveau désastre. Il n’est vraiment pas long, pourtant, à l’échelle historique, le parcours qui conduit de la chute des régimes inféodés à l’URSS en Europe de l’Est, du printemps des peuples illusoire qui l’accompagne, à la guerre en Ukraine, avec tout ce qu’elle entraîne dans son sillage...
Ici, donc, l’espérance qui naît sur les décombres d’un désastre obscur (la Guerre froide, la coupure de l’Europe en deux, la course aux armements nucléaires au cœur de l’Europe...) est bien mauvaise conseillère. Elle place inconsidérément le monde qui surgit sur les décombres de ce désastre progressivement institué dès les lendemains de la Seconde guerre mondiale, sous le signe d’une coupure émancipatrice, d’un principe de liberté (par opposition à la pesante tutelle des années soviétiques). Cette méconnaissance vitale heurte donc de plein fouet une autre nécessité tout aussi vitale : celle de la connaissance du présent que l’on habite. Cette nécessité s’associe inévitablement à la peine et même à la douleur dans un temps avide, précisément, de congédier l’une et l’autre – on a bien assez souffert comme ça, dans le temps du désastre. Or, ici, ce sont les fausses lumières de l’espérance vague, instinctive qui devraient être mises sous le boisseau. Le principe vital de connaissance du présent est ascétique, il se défie des intensités euphoriques nées de l’air du temps. Il ne connaît que trop bien le cycle de l’inflation des promesses, de la montée des illusions puis de la chute dans le grand dégoût des désillusions, de l’espérance trahie, de la montée du nihilisme. La froideur analytique nourrit la capacité du jugement sur ce qui est et ce qui vient, elle se tient à distance du règne des émotions, de la sentimentalité collective, de la tyrannie des ambiances. La sagacité a un prix : elle peut difficilement être joyeuse, s’associer au « gai savoir » insouciant, puisqu’elle consiste en premier lieu à détecter dans le présent les manifestations de la résilience du désastre – ses métamorphoses, sous un régime d’histoire où prévalent, pourtant, de radicales hétérogénéités.
Le Journal de l’année 1945 met en scène très clairement le combat des deux principes. D’un côté, dans la vie courante, Klemperer sent, pense, calcule comme si la vie recommençait, placée sous un nouveau principe lui ouvrant les portes d’une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Un nouveau lancer de dés a eu lieu, c’est le temps de la reprise et non pas seulement celui de la réparation, les puissances de la vie ont, en dépit de la profondeur abyssale du gouffre dont on s’est extrait, triomphé. On va même, dans les conditions nouvelles, s’élever plus haut que l’on n’aurait jamais pu espérer le faire dans les conditions qui précèdent l’avènement du IIIème Reich – s’engager sur la voie d’une sorte de carrière politique officielle. Klemperer devient une personnalité officielle (de second rang) du nouveau régime.
Mais, d’un autre côté, il y a toute cette froide lucidité du Journal, qui ne se dément ni ne se retient, dans les nouvelles conditions, pas davantage que sous le régime nazi : l’observation lucide des continuités cachées entre le temps du désastre et celui qui est censé le récuser et l’abolir – comme toujours, la boussole du témoin est ici la langue – la LQI emboutie dans la LTI, les habitudes mentales, l’esprit de subalternité, la bêtise administrative, les opérations de recyclage, les adaptations opportunistes... Klemperer n’est dupe de rien, lorsqu’il observe et consigne en clinicien du présent. La balise du désastre obscur est toujours là, il n’ignore pas qu’un nouveau naufrage est en gestation. Mais il n’en respecte pas moins, pour autant, la règle du jeu. C’est qu’il faut bien vivre et que la connaissance vraie du présent ne peut être, dans les conditions nouvelles comme dans celles qui les ont précédées, que marrane.
En ce sens même, le Journal de Klemperer de l’année 1945, saisit l’essentiel de l’impasse dans laquelle se trouve engagé l’après-désastre, topos revenant sans fin, se répétant sous la forme, chaque fois, de l’éclosion d’une singularité prise, précisément, dans le temps de la répétition (ou la reprise) : la vie qui reprend, après la catastrophe, ne peut se passer du support de l’optimisme, de l’espoir d’une vie meilleure et enfin désexposée, rétablie dans une durée stable, solide, en voie d’amélioration constante. Mais ce stimulant indispensable, accompagné des sensations correspondantes (un souffle printanier traverse la société, alors même que les ruines n’en finissent pas d’être relevées, que la précarité et le manque persistent...) entrave une appréhension réaliste et vérace du présent – les lunettes roses déforment la perception du réel, elles produisent une forme de fausse conscience, elles portent les vivants à ne pas s’arrêter sur tous les signes qui balisent la formation et le devenir déjà en cours d’un nouveau désastre. Le sauvetage, en ce sens, et la vie qui se relance sur ce fondement, le sauvetage qui emprunte le chemin terrible des désastres partiels épargnant à la collectivité qui les subit un désastre total, cette figure même est un faux-semblant, un leurre. On en trouve un parfait exemple avec les justifications fallacieuses que les dirigeants des Etats-Unis ont constamment mises en avant afin de justifier le recours à l’arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki – celui-ci aurait épargné au Japon la destruction totale en mettant fin à la guerre, tout comme il l’aurait fait de « centaines de milliers de vie américaines ». Ce serait là l’usage supposément prophylactique de la terreur ; tout comme, sur le front européen, avec les urbicides de Dresde et Hambourg.
Mais la procédure même d’interruption du désastre en cours (les guerres de conquête conduites par des régimes fascistes) contient ici en germe de façon évidente d’autres désastres : le monde d’après-Hiroshima, c’est celui d’un nouvel ordre surplombé par l’ombre de la terreur nucléaire (Günther Anders : Hiroshima est partout, et sans terme [3]). L’interruption du désastre en cours sur un mode terroriste recèle une puissance désastreuse : le propre des après-guerres avides de retour à la paix et à la stabilité en forme de reconstruction est de rendre ce trait méconnaissable, de l’enfouir sous les ruines du monde d’hier. Aussi, le monde en paix qui s’érige sur les ruines de la catastrophe est-il marqué du sceau du mensonge. Cette paix n’est que le faux-nez du nouveau désastre qui s’annonce : deux ans après les démonstrations de force administrant la terreur aérienne en grand, destinées à briser l’échine du régime nazi, le visage du nouveau désastre est déjà dessiné sur la carte de l’Europe – la guerre froide, la course aux armements, les prémisses d’une nouvelle guerre mondiale. Celle-ci n’aura pas lieu, mais on est là dans le domaine de l’aléatoire, des facteurs contingents – nullement de la Raison dans l’Histoire (une pseudo-rationalité historique indexée sur la supposée sagesse de la dissuasion nucléaire, de l’équilibre de la terreur). La prophylaxie du désastre pratiquée par les Alliés a mis fin à un désastre en semant les graines d’un ou de plusieurs autres : la Guerre froide, la course aux armements, l’âge atomique... Tout se passe donc en la matière comme si le mal n’était jamais guéri que par le mal – ici se dessine l’ample débouché de la philosophie de l’Histoire du présent sur la philosophie morale.
On identifie chez Klemperer une singulière combinaison d’optimisme déraisonnable et de pessimisme de la raison. Il est en effet rigoureusement déraisonnable de s’obstiner (compte tenu de ce qu’est sa condition propre) à demeurer en Allemagne après 1933, et toujours davantage au fur et à mesure que les conditions s’aggravent, en ne renonçant jamais entièrement à l’espoir d’un effondrement inopiné du régime – alors même que tous les signes que relève l’observateur sagace et pointilleux qu’il est lui-même tendent à indiquer au contraire que le régime s’est stabilisé en politique intérieure et que tout lui réussit en politique extérieure. Cet optimisme déraisonnable résultant d’une combinaison indéracinable de propension à espérer, d’inertie et d’attachement à son lieu de vie relève d’une pulsion plutôt que de calculs. Il est en tout cas le fondement du choix (plutôt que de la décision, à proprement parler) de ne pas partir (ou plutôt que de rester, de renoncer à bouger, ce qui est sensiblement différent) – une option partagée par les deux époux, pour des motifs sans doute sensiblement différents).
Cet optimisme est bien déraisonnable puisqu’il conduit Klemperer, au bord de la mort – Auschwitz. Seul le cataclysme-miracle le sauve.
Mais d’un autre côté, durant les douze années du IIIème Reich, la très grande majorité des observations que consigne le diariste est située sous le signe d’une lucidité qui place le pessimisme au poste de commande. C’est le principe même qui préside à une enquête conduite en suivant le fil de la langue – la saisie opérée sur celle-ci par les nazis indique que le mal plonge désormais ses racines au plus profond dans la société même, il est dans les têtes et dans les bouches, pas seulement dans les appareils de pouvoir. Le Journal tient le procès-verbal de la constante progression du mal, il est, pour tout ce qui concerne l’observation des conduites, des phénomènes de croyance, de l’aveuglement partagé sur l’état réel de la situation (la montée de la terreur, les menaces de guerre...) placé sous le signe de l’irréversible – rien ne semble pouvoir arrêter la montée en puissance du régime, Hitler surmonte tous les obstacles se dressant sur sa voie, le voici bientôt maître de l’Europe et, pourquoi pas, du monde, tandis qu’en politique intérieure, toutes les résistances et oppositions ont été, de longue date, éliminées.
Il n’échappe pas du reste à Klemperer que cette irrésistible montée en puissance est une marche vers l’abîme – que Hitler l’emporte sur ce qui tente de résister à sa marche triomphale ou qu’il soit vaincu – l’issue sera, dans tous les cas, apocalyptique. Pour cette raison même, le Journal de ces années est placé tout entier sous un signe de mort. Klemperer n’ignore pas que l’empirement constant des conditions générales dont il consigne les signes multiples se traduit, pour ce qui le concerne, par l’accroissement incessant, implacable, des menaces pesant directement sur sa vie. Et pourtant, il n’en finit pas d’ « espérer » et pour soutenir cette espérance littéralement folle, de travailler, de se consacrer à ses recherches dans des conditions de plus en plus impossibles ; tout en demeurant inébranlable dans sa détermination à faire comme si l’avalanche toujours plus près de l’ensevelir n’existait pas.
Quelque chose d’une structure existentielle placée sous le signe de l’omniprésence du désastre (d’une consistance désastreuse du présent) se dévoile ici. Plus le pessimisme de la raison et la sagacité analytique nourrissent la certitude que les conditions générales (dans lesquelles est saisie, engluée la situation du narrateur) empirent, plus les mâchoires du piège (la terreur) sont près de se refermer, et plus la petite musique de l’espérance persiste à refuser de s’éteindre – mais tout de même, qui sait, peut-être bien que...?
On ne peut pas se retenir d’espérer, au cœur même du désastre, alors même que celui-ci impose ses conditions sur un mode toujours plus draconien. L’espérance ne peut rien contre le terrible, bien sûr, entendu comme régime d’Histoire, mais elle constitue la plus constante des pulsions permettant d’y survivre provisoirement, d’y surnager, fût-ce pour un instant encore. Il s’agit bien ici d’entretenir à des fins vitales (ou plutôt de survie) la méconnaissance de ce que, au demeurant, on connaît d’un savoir assuré. Dans son essai sur la fausse conscience, Joseph Gabel rapproche l’idéologie de la schizophrénie [4]. On pourrait ici, dans le même sens, décrire la coexistence non dialectique du pessimisme de la raison et de l’optimisme de survie comme relevant distinctement d’une structure schizophrénique – une forme de psychose, donc.
Cela décrirait sans doute, sommairement mais non sans exactitude, notre relation au désastre entendu tant comme notre milieu de vie que comme ce qui surplombe notre condition historique.
Un trait marquant autant que constant du Journal est l’extrême variabilité des dispositions qui s’y manifestent, au fil des jours et au gré de l’évolution de la situation des persécutés, des événements. C’est généralement le pessimisme radical qui donne le ton, tant pour ce qui concerne le cours général des choses que les conditions propres au couple Klemperer. Mais ce ton n’est pas uniforme et l’espérance opère régulièrement des percées qui, pour être infimes, n’en actualisent pas moins la tension perpétuelle qui définit en propre la condition ontologique dont témoigne le Journal des années nazies, d’un bout à l’autre.
Du point de vue de la perception du temps (ou peut-être même d’une philosophie pratique de la temporalité), cette tension se traduit ainsi : globalement, dans la durée, le temps travaille pour les criminels persécuteurs, contre les réprouvés et les victimes désignées. Mais en même temps, la puissance des persécuteurs n’est pas établie pour l’éternité ; elle-même présente des signes de faiblesses et la raison même (pas seulement l’espérance déraisonnable) dicte aux persécutés la conviction que sa fin viendra. Ici prend consistance la figure d’une course contre le temps, une course contre la mort : les persécutés survivront si la puissance des persécuteurs s’effondre (est détruite par une autre puissance) avant qu’ils n’aient eu le temps de venir à bout des derniers persécutés. Tant que le dernier des Juifs n’aura pas été déporté vers un camp de la mort, la notion même de cette course conservera son actualité. Or, à plus d’un égard, Klemperer est bien, dans sa situation propre, l’incarnation même de ce dernier des Juifs (ils ne sont plus qu’une poignée à Dresde lorsque survient le bombardement) et, qui plus est, notion essentielle, il se trouve que ce dernier s’active inlassablement à témoigner de sa situation et de cette figure de l’affrontement entre le temps des persécuteurs et celui des persécutés. Le Journal témoigne d’une sorte de guerre des temporalités, de l’affrontement jusqu’à la mort entre la durée de la terreur et l’endurance des survivants. Ceux qui n’ont pas les moyens de résister activement espèrent en dépit de tout que les circonstances leur accorderont une durée plus longue que celle qui reviendra à leur persécuteur. La figure messianique serait ici qu’il y suffit d’un instant – cet instant de plus serait celui de leur victoire contre la tyrannie, contre le destin. Un long instant, dans le cas de Klemperer, et que l’on pourrait appeler l’ « instant RDA » – quinze ans (1945-1960).
Au plan existentiel, enfin, le jeu des oppositions actualisant la tension structurelle entre les deux pôles se repère facilement dans le Journal : profusion d’images apocalyptiques placées sous le signe de la fin terrible (la prison de la Gestapo, la déportation, le camp, la maladie, le pogrom, les bombardements...) et, à l’opposé, l’indéracinable envie de vivre, le désir éperdu du sursis, aussi infime soit-il, et surtout quand la situation semble absolument sans issue. Vivre, cela tient à quelques éclats d’images actualisant le désirable : un supplément d’instants partagés avec Eva, le livre sur le XVIIIème siècle français à achever, quelques belles échappées dans les campagnes environnantes, un bon repas dans une auberge, et, pourquoi pas, la ligne d’horizon de l’impossible n’étant jamais fixée une fois pour toutes, la reprise de l’enseignement, une chaire, un poste à l’Université – avec logement et voiture... Il est remarquable que, dans le Journal, même aux moments les plus noirs, cette tension persiste à peu près jusqu’au bout. Il ne suffisait assurément pas d’être un possédé de l’espérance pour survivre, dans cette situation, mais cela en était une condition. L’énigmatique combinaison du pessimisme fondamental (et de sa fidèle compagne, la dépression) et de l’espérance envers et contre tout a accompagné Klemperer jusqu’aux dernières étapes du voyage en enfer.
Alain Brossat